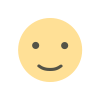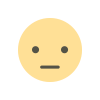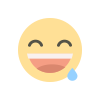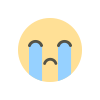La rue israélienne gronde, enfin
La rue israélienne gronde, enfin

Il y avait quelque chose de réconfortant à voir des centaines de milliers d’Israéliens manifester dans les grandes villes du pays, dimanche, pour réclamer la libération des otages et la fin de la guerre dans la bande de Gaza. Enfin, la rue israélienne gronde. Enfin, elle crie sa révolte face à l’innommable.
Bien sûr, l’État hébreu ne se réduit pas à son gouvernement, surtout pas aux exaltés de l’extrême droite religieuse, au sein du cabinet, pour qui les atrocités du 7–Octobre sont devenues un prétexte pour réoccuper Gaza et conquérir toujours plus de territoires en Cisjordanie, trouant la Palestine comme un morceau de gruyère dans l’espoir qu’elle ne devienne bientôt qu’un mauvais souvenir.
Tout de même : jusque-là, les voix discordantes avaient été plutôt timides en Israël. Dans un sondage mené à la fin de juillet, 79 % des juifs israéliens avaient déclaré ne pas être préoccupés par les informations faisant état de la faim et des souffrances des habitants à Gaza. Une indifférence troublante au sein de cette nation qui sait mieux que toute autre nation où peut mener la déshumanisation d’une population.
Il faut dire que, depuis près de deux ans, les Israéliens n’ont pas eu accès aux mêmes informations que le reste de la planète. On ne parle pas de Gaza à la télé israélienne comme on en parle ailleurs dans le monde. Aux bulletins de nouvelles, on montre rarement les images sanglantes, les quartiers en ruine, les enfants désespérés qui tendent leurs bols vides.
On n’en parle pas parce que beaucoup de gens, là-bas, ne veulent pas le savoir. Essayons de nous mettre à leur place, deux secondes.
Nous aurions été nombreux à réagir de la même manière si, chez nous, des villages avaient été attaqués, si des familles avaient été massacrées, si des innocents croupissaient depuis 22 mois dans de sombres tunnels. Nous voudrions, nous aussi, que tout soit fait pour éradiquer la menace existentielle pesant sur nos têtes. Mais ce n’est plus de cela qu’il s’agit.
Aujourd’hui, ni les Israéliens ni le reste du monde ne peuvent détourner le regard. Devant l’évidence, l’indicible souffrance, plus personne ne peut nier que, loin de mener une guerre juste contre le Hamas, le gouvernement israélien se livre à d’effroyables crimes de guerre à Gaza.
L’humeur des Israéliens commence donc à changer. Des réservistes se montrent réticents à mener une guerre sans fin. Des journalistes notent les différences entre leur couverture du conflit et celle des médias internationaux. Des intellectuels réclament la fin de la guerre. Des politiciens se rallient – y compris deux anciens premiers ministres, Ehud Olmert et Ehud Barak. « Mon cœur est brisé, mais je dois le dire : c’est un génocide », a déclaré David Grossman, l’un des plus célèbres romanciers du pays.
Plus significatif encore, 600 membres de l’armée et des services de renseignement, dont d’anciens chefs du Mossad et du Shin Bet, ont publié une lettre appelant à la fin de l’opération militaire à Gaza. « Selon notre jugement professionnel, le Hamas ne représente plus une menace stratégique pour Israël », ont-ils écrit. L’essentiel des objectifs militaires a été atteint ; continuer ne servirait à rien. Ça risquerait même de mettre en danger la vie des derniers otages.
Enfermé dans une logique guerrière destructrice, le premier ministre Benyamin Nétanyahou n’a malheureusement aucune intention de s’arrêter. Coûte que coûte, il poursuit sa fuite en avant. Prochain désastre à venir : la prise de contrôle de la ville de Gaza. Officiellement, pour éradiquer ce qu’il reste du Hamas.
Mais selon le Wall Street Journal, Israël négocierait en ce moment avec l’Égypte, la Libye, le Soudan du Sud, le Somaliland et la Syrie pour que ces pays ouvrent leurs portes aux Palestiniens qui « accepteraient » de quitter Gaza.
J’écris tout cela en sachant que certains vont me dire que A) j’y vais un peu fort, quand même, ou B) je manque de courage, il faut l’écrire noir sur blanc, c’est un génocide. Peut-être bien. Appelez ça comme vous voulez, ça ne change rien aux horreurs qu’endurent les Gazaouis depuis près de deux ans.
Maintenant, essayons de nous mettre à leur place, deux secondes. La bande de Gaza couvre un territoire de 365 km2, soit la superficie de la ville de Montréal. Nous sommes assiégés. Impossible de fuir. L’aide alimentaire entre au compte-goutte. Autour de nous, les gens crèvent de faim. Ou d’autre chose. On nous a déjà envoyé 100 000 tonnes d’explosifs sur la tête – plus que ce qu’ont reçu les villes de Londres, Dresde et Hambourg réunies pendant la Seconde Guerre mondiale !
L’ampleur de la destruction est inouïe : 70 % des infrastructures de la ville sont en ruine. Les hôpitaux et les gratte-ciels du centre-ville se sont effondrés depuis longtemps. La plupart d’entre nous ont été déplacés à plusieurs reprises. Cette fois, nous ne pourrons plus rentrer à la maison : notre quartier a été rasé au bulldozer. Le dernier bilan officiel fait état de 62 004 morts – mais il y en aurait bien davantage, selon une évaluation du journal médical The Lancet.
Des habitants racontent leurs histoires déchirantes aux médias de la planète, par l’entremise des réseaux sociaux. Les travailleurs humanitaires qui œuvrent sur place parlent d’une crise humanitaire sans précédent. Mais nos assaillants affirment que tout cela est faux. De la pure propagande. En même temps, ils interdisent aux correspondants étrangers l’accès à notre ville assiégée pour rendre compte de ce qui s’y passe réellement.
Pire, ils éliminent les journalistes locaux qui collaborent avec la presse étrangère en les accusant d’être des terroristes. Chaque fois, ils coupent un de nos derniers liens avec le reste du monde. Et ça, ce n’est pas une fake news.
What's Your Reaction?